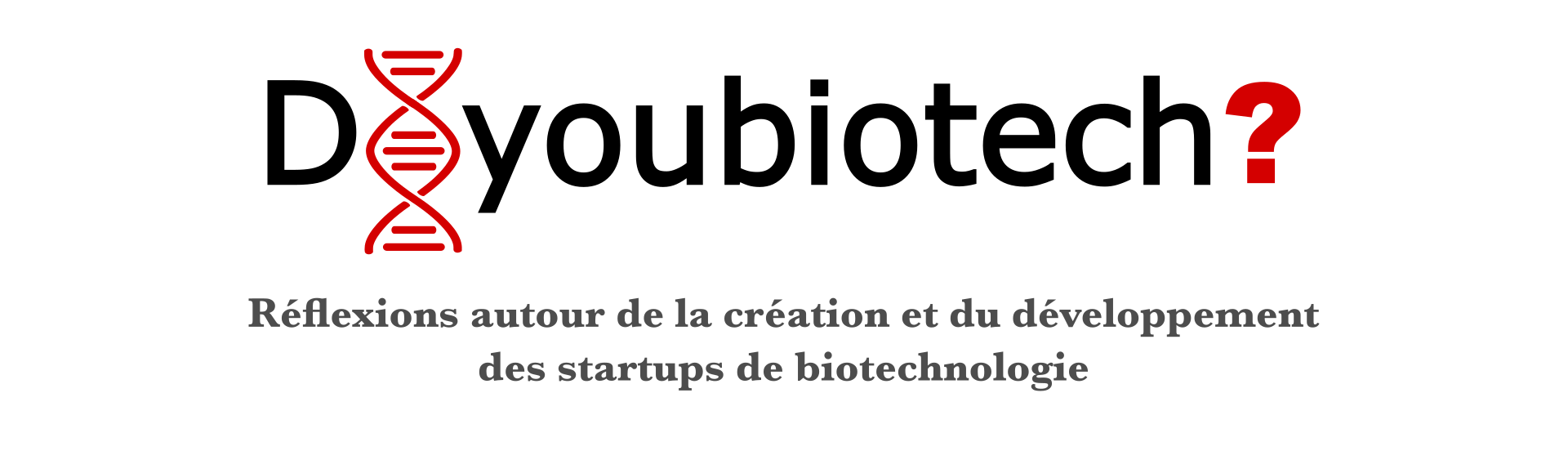Vous êtes-vous demandé comment naissaient les entreprises de biotechnologie ? Quand on regarde les entreprises connues du grand public, on a un peu l’impression qu’elles ont toujours été là, qu’elles ont toujours eu plusieurs dizaines d’employés. Que nenni !
Si on considère un parcours réussi pour une biotech thérapeutique, il partira d’un concept scientifique ou technologique et se terminera, la plupart du temps, par un rachat par une grande entreprise pharmaceutique. Quelques biotech deviennent elles-mêmes des acteurs majeurs (Amgen par exemple) mais même avec des valeurs boursières dépassant les 10 milliards de dollars, elles finissent régulièrement acquises par des Big Pharmas.
Entre ces deux extrémités, la biotech va passer par des étapes quasi obligatoires qui correspondront à des tailles et à des besoins de financement spécifiques.
Nous allons décrire ces phases dans les prochains articles.
Au commencement était la science…
La phase d’amorçage : d’une technologie ou d’une découverte scientifique à la création d’une entreprise
En dehors des spin offs (c’est-à-dire des entreprises créées à partir des « actifs » (brevets, candidats médicaments, outils industriel, etc.) d’une autre, pour laquelle ces actifs ne sont pas stratégiques), presque toutes les biotechs sont issues d’une découverte scientifique pour laquelle les chercheurs impliqués, ou leurs structures de valorisation, ont identifié une potentielle application thérapeutique. Le point de départ d’une biotech est donc un corpus de données scientifiques, souvent résumées dans un ou plusieurs articles scientifiques, et un ou des brevets.
En fonction des cas, le chercheur (ou son directeur de laboratoire) peut décider d’initier la recherche d’un financement pour créer une entreprise ou bien ce sera l’initiative de la structure de valorisation. En France, typiquement, les structures « INSERM Transfert » et « CNRS Valorisation » seront impliquées, avec éventuellement l’université concernée. La dénomination juridique de ces structures est « SATT » pour « société d’accélération et de transfert technologique ». Leur objet social est de transformer les découvertes scientifiques en innovation et, in fine, en application dans le monde réel (en anglais on parle de TTO pour Tech Transfer Office).
La première étape est d’identifier un « porteur de projet » (en général le futur CEO) qui va devoir articuler une vision stratégique du potentiel de l’innovation afin de convaincre des acteurs spécialisés de financer le lancement d’une biotech.
Cette première étape est appelée « amorçage » ou « seed » en anglais. La nouvelle entreprise est généralement composée uniquement de son « porteur de projet » dont la mission est d’obtenir les financements permettant de recruter les premiers employés et de démarrer le travail.
D’un jalon à l’autre
Dans le monde des startups de biotechnologie (dans le sens d’entreprise non rentable dont l’activité principale est la recherche et développement), on finance une entreprise pour qu’elle réalise un travail dont les résultats détermineront s’il est pertinent de financer l’entreprise jusqu’à l’étape d’après. On parle d’atteindre des jalons de création de valeurs.
Ces jalons sont plus ou moins standardisés et, en général, ils peuvent se résumer à ceci :
- Obtenir une preuve de concept expérimental
- Obtenir un candidat médicament
- Démarrer les essais cliniques
- Obtenir une preuve de concept clinique
- Obtenir l’autorisation de mise sur le marché
- (éventuellement) L’expansion du pipeline
- (éventuellement) l’entrée en bourse
- (éventuellement) La commercialisation
- Le rachat de l’entreprise ou la vente de son candidat médicament
Aujourd’hui nous allons traiter des points 1 et 2.
La preuve de concept expérimentale.
Cette étape est encore une étape de recherche, très proche du travail académique. Il s’agit de conduire des expériences, souvent en utilisant des animaux de laboratoires comme modèles expérimentaux, pour obtenir le même type de démonstration qu’on attendrait dans un article scientifique pour qu’il soit publié. Le travail ne fera pas toujours l’objet d’une publication dans un journal scientifique mais la validation par les paires, par exemple sous la forme de la présentation d’un poster dans une conférence scientifique, est vue comme une étape importante.
Cette première étape, visant à confirmer les travaux initiaux ayant conduit à la création de l’entreprise est souvent financée par des bourses à l’innovation. En France, la banque publique d’investissement « BPIfrance » organise par exemple chaque année un concours d’innovation appelé « iLAB » qui distribue des bourses pouvant atteindre plus d’un million d’euros. Les SATT ont aussi parfois des programmes d’accompagnement qui proposent des aides, éventuellement financières, mais surtout du type « en nature ». Elles peuvent par exemple fournir des bureaux, l’accès à un réseau de professionnel spécialistes du domaine (comptable, RH, etc.) et des formations sur différents aspects du lancement d’une startup de biotechnologie.
De manière générale, en France, la BPI et les autres institutions publiques sont des acteurs quasi incontournables du lancement des startups biotech. D’autant que l’obtention de ces bourses sert souvent d’étape incontournable pour commencer à intéresser des acteurs privés du financement.
Pour ceux qui ont déjà une expérience réussie dans le lancement d’une biotech, ils ont parfois accès directement aux acteurs privés du capital-risque.
Durant cette phase, pendant que les travaux scientifiques ont lieu, l’équipe est généralement restreinte à la portion congrue avec le porteur de projet, un scientifique réalisant les expériences et parfois un directeur des opérations. En dehors du travail scientifique, l’équipe se concentre sur la construction d’un argumentaire scientifique et business (in fine, on produit des présentations PowerPoints et des documents Word pendant cette phase), le fait de préparer les futurs recrutements en identifiant les candidats potentiels, la structuration de l’entreprise avec l’identification des différents fournisseurs de service (RH, comptabilité, juridique) et la recherche de locaux. Un temps non-négligeable est passé à remplir des dossiers de candidatures pour de nouvelles bourses à l’innovation, auprès par exemple de la Banque Européenne d’Investissement.
Si les résultats obtenus confirment la pertinence de l’hypothèse initiale, ils vont servir de base au « pitch » pour obtenir les premiers financements privés. Il faut alors commencer le travail dit de « levée de fonds ». En présentant le potentiel scientifique et thérapeutique, l’équipe va chercher à convaincre des professionnels du financement de l’innovation (les « VC » ou Venture Capitalists) de financer l’entreprise pour qu’elle puisse identifier un candidat médicament. Il s’agit d’une molécule dont la structure est arrêtée et qui va ensuite être utilisée dans les phases d’évaluation réglementaire, en vue de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.
Ce financement par des VCs sera en général appelée une « Série A' » (une dénomination qui permet d’identifier les droits spécifiques qui seront attachées aux actions créées pour être vendues aux investisseurs de la Série A). Les montants en jeu dépendent des pays (c’est plus aux USA qu’en France par exemple), de la météo du moment sur les marchés financiers et du type de thérapies développées. Dernièrement, ces financements vont de quelques millions à quelques dizaines de millions d’euros.
L’obtention d’un candidat médicament
A ce stade, il s’agit tout d’abord de convaincre ses investisseurs que le futur médicament a une chance raisonnable de fonctionner d’un point de vue thérapeutique mais aussi commercial. Il faut prendre en compte les standards de traitement, l’environnement concurrentiel (les autres médicaments en développement) pour comprendre comment développer un médicament qui pourra rapporter plus que ce qu’il va coûter à développer. On appelle cette étape la définition des Caractéristiques Cibles du Produit (TPP en anglais pour Target Product Profile). On peut par exemple identifier que, pour avoir une chance d’être prescrit suffisamment, notre produit cible doit être 50% plus efficace que tel médicament de référence ou bien doit avoir une moindre toxicité rénale.
A partir de ce TPP, on va définir une série d’expérience pour vérifier si notre candidat a bien les caractéristiques minimales désirées.
Bravo ! Votre produit atteint les caractéristiques cibles que vous avez fixées, il devient officiellement un « Candidat Médicament ». Il faut maintenant lancer les étapes de « développement » pour continuer d’avancer vers la mise sur le marché.
La suite, au prochain épisode…